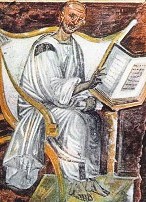
La paroisse Saint-Augustin en nord-clunisois
fondé en 2004 Par Monseigneur Séguy regroupe 18 villages.
Pour découvrir les églises de notre paroisse et leur vocable cliquer sur le nom du village dans le sommaire à gauche.
(Notre site est en construction, si vous avez des connaissances sur l'histoire de nos églises et que vous acceptez de les voir publiées sur ce site n'hésitez pas à nous les transmettre :
postmaster@paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr)
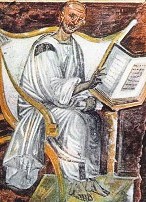
En ouvrant cette biographie, nous voudrions dire un mot du portrait de Saint
Augustin qui apparaît désormais en première page de notre bulletin de liaison.
Ce portrait, le plus vénérable connu, est celui qui figure sur la fresque du Latran qui date du VIème siècle.
Le pape Grégoire le Grand avait fait aménager dans la partie du palais qu’on appelle Sancta sanctorum, une bibliothèque aussi fournie que possible. Et suivant la coutume antique, il la fit orner de portraits d’hommes illustres, en particulier, de Pères de l’Eglise. Celui d’Augustin illustrait le « département » où se trouvaient conservées ses œuvres.
C’est probablement la reproduction d’un tableau qui avait été fait du vivant d’Augustin et qui accompagnait sa bibliothèque lors de son transfert à Rome vers 445.
Augustin est vêtu à l’antique, tunique et pallium ; il tient dans sa main gauche un rouleau de ses œuvres, de la droite il désigne le Livre par excellence, la Bible, dont il explique le sens mystique, c’est à dire le Christ, sens plénier des Ecritures.
Il prêche, et il faut simplement imaginer ses auditeurs pressés autour de lui pour l’écouter.
Il n’a pas de costume clérical ou liturgique. Dans sa Règle aux religieux, Augustin dit :
« Que votre tenue ne soit pas voyante. » Et dans un sermon il dit aux fidèles : « Ne m’offrez pas un vêtement de luxe ; cela convient peut-être à un évêque, mais cela ne convient pas à Augustin, pauvre et fils de pauvres. »
Il y a là, probablement quelque malice à l’égard d’autres évêques de cette époque, moins soucieux de pauvreté.
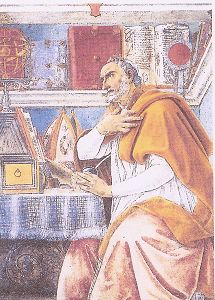 Né le 13 novembre 354,
Augustin, son frère Navigius et sa sœur ( dont on
ignore le prénom ), étaient les enfants de Patricius
et Monique, petits propriétaires terriens,
exploitants agricoles à Thagaste (aujourd’hui Souk
Ahras, aux confins de l’Algérie et de la Tunisie),
au cœur de l’Afrique romaine qui couvrait grosso
modo le Maghreb actuel, région prospère à
l’époque, « grenier de Rome », l’approvisionnant en
céréales, huile d’olive et vins.
Né le 13 novembre 354,
Augustin, son frère Navigius et sa sœur ( dont on
ignore le prénom ), étaient les enfants de Patricius
et Monique, petits propriétaires terriens,
exploitants agricoles à Thagaste (aujourd’hui Souk
Ahras, aux confins de l’Algérie et de la Tunisie),
au cœur de l’Afrique romaine qui couvrait grosso
modo le Maghreb actuel, région prospère à
l’époque, « grenier de Rome », l’approvisionnant en
céréales, huile d’olive et vins.
Augustin, son frère et sa sœur vécurent là une enfance heureuse. Il nous dit pourtant qu’il n’aimait pas l’école et ses brutalités ; on le comprend. Mais son intelligence y brilla rapidement, et ses parents firent tout ce qu’ils pouvaient pour favoriser sa réussite, sa « promotion sociale » dont ils espéraient profiter eux-aussi. Il fit donc d’excellentes études primaires, secondaires, et finalement universitaires à Carthage ; et il devint bientôt professeur de lettres.
Le couple parental était mixte. Monique était une bonne chrétienne, Patrice un brave païen qui ne fit pas obstacle à ce que la mère donnât une éducation chrétienne aux enfants. Bébé, Augustin reçut le sacrement des catéchumènes : le signe de la croix sur le front, les grains de sel sur les lèvres, ce qu’on appelait autrefois les rites préliminaires du baptême. Plus tard, à sept ans peut-être, il tomba gravement malade ; en danger de mort, il réclama instamment le baptême. Mais il se rétablit et on différa la cérémonie. Il y avait en effet à l’époque, deux catégories de chrétiens, les « fidèles » : ceux qui avaient reçu le baptême, sacrement de la foi, et promis de vivre en bons chrétiens ; et les catéchumènes qui préféraient se tenir confortablement sur le seuil, en se disant qu'il serait toujours temps de faire le nécessaire plus tard.
Augustin fut donc toujours chrétien : « Il avait bu, dit-il, le nom de son Sauveur avec le lait de sa mère et il le retenait au fond de son cœur d’enfant. » mais il est probable qu’il n’y pensait guère au cours des années folles de son adolescence.
A dix-sept/dix-huit ans, étudiant à Carthage, il se lia à une compagne qui lui donna un enfant. Ils le prénommèrent Adéodat, « Dieudonné ». Bon père, Augustin dit que l’enfant non désiré sut, une fois né, se faire aimer. C’est naturel ! Adéodat, âgé de quinze ans reçut le baptême à Milan en même temps qu’Augustin dans la nuit pascale de 387. De retour à Thagaste, le père continua l’éducation de son fils surdoué qui mourut prématurément vers l’âge de dix-huit ans, de maladie ou par accident, on ne sait. Mais son père édita peu après, en guise de mémorial, un beau dialogue intitulé Le Maître (= le Christ ), en assurant que tout ce qui y est prêté à Adéodat est bien de lui. Il n’y a pas de raison sérieuse d’en douter.
Entre-temps Augustin ne fut jamais un « prof peinard », sans autres soucis que professionnels, sentimentaux et familiaux, car il avait lu un dialogue philosophique de Cicéron qui l’avait enthousiasmé. Dès lors il était déstabilisé, pris entre son amour de la Sagesse (=la philosophie ) et ses passions de jeune homme ardent et ambitieux ; et il partait dans une longue quête de la Vérité.
Suite de notre approche de Saint Augustin, une troisième grande œuvre : La Cité de Dieu.
A Carthage, certains hauts responsables contestaient la compatibilité du christianisme avec le service de l’Etat. C’est pour répondre à cette contestation qu’Augustin s’engagea, pour des années, dans une grande apologie du christianisme.
L’ouvrage comporte 22 chapitres. Les 10 premiers dénoncent et réfutent avec verve, sans pitié, les aberrations de toutes sortes de cultes rendus aux dieux des nations, qui sont et ne sont que des démons.
Les 12 autres chapitres décrivent l’histoire de deux Cités, leurs origines, leurs développements, leurs fins, en commentant les sept premiers livres de la Bible et les livres des Prophètes :
« Deux amours ont fait deux Cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la Cité terrestre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la Cité céleste. »
Augustin emprunte ces qualificatifs à saint Paul qui opposait Adam, l’homme terrestre, et le Christ, l’homme céleste.
Dans la Cité terrestre, la sagesse orgueilleuse, se dégrade en idôlatrie ; dans l’autre, au contraire, il n’est pas d’autre sagesse que la piété par laquelle on adore en vérité le vrai Dieu, la piété qui attend comme récompense dans la société des saints, hommes et anges, que Dieu soit « tout en tous ».
Ces deux Cités sont appelées mystiquement Babylone et Jérusalem dans les saintes Ecritures. Elles sont emmêlées, enchevêtrées, jusqu’au Jugement dernier. Ne cherchons pas surtout dans La Cité de Dieu une théologie politique des rapports de l’Eglise et de l’Etat. C’est un contresens fatal qui a été malheureusement commis au Moyen Âge….
Babylone signifie « confusion » ; c’est Babel, l’embrouille de la vie du genre humain, le monde des hommes vendu au pouvoir du péché, comme dit saint Paul, ravagé par les méfaits de l’orgueil : l’égoïsme, la jalousie, la volonté de puissance, les dissensions, les guerres et toutes les misères qui s’ensuivent.
Jérusalem signifie « vision de la paix », la paix de Dieu « tout en tous » dans la Vie éternelle ! L’objet de notre foi, de notre espérance, de notre amour !
Fils d’Adam pécheurs, nous naissons tous à Babylone. N’en soyons pas les citoyens, ne soyons pas des idolâtres, victimes des démons qui occupent ce monde. Prenons conscience de notre exil : dans ce monde, dans les tribulations du siècle, dans la cohue des scandales, nous gémissons comme en captivité.
« Au bord des fleuves de Babylone, nous sommes assis et nous pleurons ; nous avons suspendu nos harpes aux saules des rives, arbres stériles » (Ps 136) ; nous n’avons pas le cœur à chanter les chants de Sion à Babylone.
Sortons de Babylone !
Et nous voici en pèlerinage : nous allons vers la maison de Dieu et nous chantons les psaumes des montées : « Heureux celui dont Tu es le soutien. Seigneur ! Tu as disposé des montées dans son cœur ». (Ps 83, 6).
Notre pèlerinage est intérieur : l’Esprit Saint, le don de Dieu, nous enflamme et nous allons, nous montons les montées du cœur et nous chantons le cantique des degrés.
« Ton
feu, ô Dieu, nous
embrase et nous porte en haut vers la paix de la Jérusalem
céleste. »
Source : Portrait de Saint Augustin, de Goulven Madec
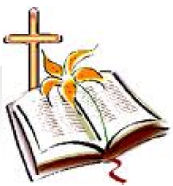 Le Christ total est donc Tête et Corps, comme un homme en son intégrité….
Le Christ total est donc Tête et Corps, comme un homme en son intégrité….